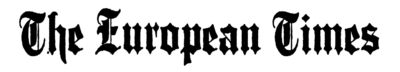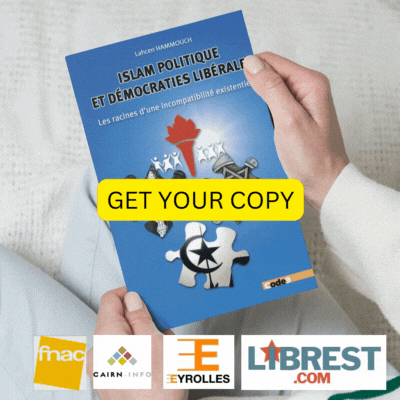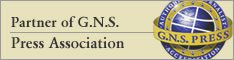Couvert de controverse : la tentative de la France d'interdire les symboles religieux met en péril la diversité...
Envie de collations après un repas ? Il s'agit peut-être de neurones en quête de nourriture, non...
Voici une sélection d'articles qui contribuent à une meilleure prise de conscience de la société